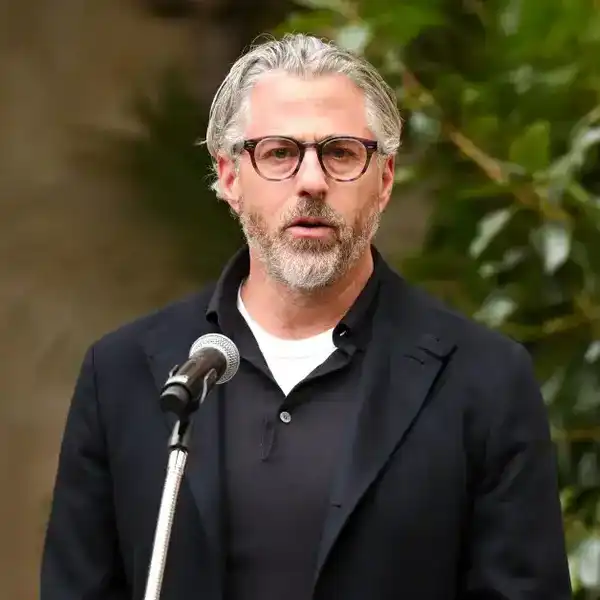Vingt ans plus tard, le Prix de musique Polaris reste fidèle à son ADN
Le Montréalais Yves Jarvis décroche le prix de 30 000 $ de l’album canadien de l’année pour All Cylinders, tandis que Mustafa remporte le tout premier Prix de la chanson SOCAN Polaris pour « Gaza Is Calling ».

Pochettes d'album d'Yves Jarvis et Mustafa
Depuis 20 ans, le Prix de musique Polaris ne fait aucun compromis. Le choix du lauréat de cette année en est la preuve.
Le musicien montréalais Yves Jarvis a remporté hier soir (16 septembre) le prix de 30 000 $ pour l’album canadien de l’année avec All Cylinders, lors du gala présenté au Massey Hall de Toronto et diffusé en direct sur CBC Gem et YouTube.
Jarvis a produit l’album lui-même après être revenu de Los Angeles chez ses parents à Montréal. Il a raconté avoir subi une commotion cérébrale en se cognant la tête contre le plafond bas de la chambre d’amis où il a enregistré le disque.
« J’ai réalisé la majeure partie de mon travail avec un budget dérisoire, et je ne pensais même pas que ce serait ce disque-là », a-t-il confié. « Je suis vraiment heureux d’être reconnu de cette manière et d’être un ambassadeur de l’art canadien. »
All Cylinders s’est imposé face à neuf autres albums finalistes en 2025, dont ceux de Nemahsis, Mustafa, Saya Gray, Marie Davidson et plusieurs autres. Presque tous les artistes se sont produits sur scène, remplissant la salle de sonorités allant du prog à la techno, en passant par le punk et la pop francophone. Aucun album ne s’étant particulièrement démarqué cette année, la sélection finale s’est révélée plus ardue que jamais.
Étant né d’un modèle critique inspiré du Mercury Prize britannique, le Prix de musique Polaris pousse souvent à chercher dans l’album gagnant un reflet du paysage musical canadien. Si All Cylinders incarne quelque chose cette année, c’est bien l’identité même du prix. L’album d’Yves Jarvis illustre parfaitement ce que le Polaris prétend défendre : une récompense fondée uniquement sur le mérite artistique, sans égard pour le label, le genre ou la classification. Unique et intransigeant, le disque déconstruit des fragments de rock, de funk ou de psychédélisme, pour ensuite les réassembler de façon volontairement chaotique.
Au sommet de sa reconnaissance, au début des années 2000, le Prix Polaris possédait un véritable prestige culturel. La victoire de Fucked Up (2009) ou de Lido Pimienta (2017) pouvait propulser un artiste vers de plus grandes scènes, attirer l’attention des médias internationaux et nourrir d’innombrables débats dans les bars. Haviah Mighty, lauréate en 2019 pour son album indépendant 13th Floor, animait le gala cette année et a reconnu qu’elle n’avait aucune idée où sa carrière se serait dirigée sans cette victoire.
Ces dernières années, le prix a toutefois été critiqué de la même manière qu’à ses débuts, lorsqu’on le qualifiait de « prix indépendant » — réservé à de plus petits artistes, plus marginaux, qui « avaient besoin de l’argent ». Une étiquette un peu réductrice dès 2006, lorsque Owen Pallett a remporté le tout premier prix pour He Poos Clouds, et qui ne correspond toujours pas à la réalité actuelle. Le Polaris n’a jamais été pensé comme un tremplin pour les plus petits, mais bien comme une distinction indépendante de toute popularité, récompensant le « meilleur » album, qu’il provienne d’un collectif underground ou de la plus grande star mondiale. Arcade Fire (The Suburbs, 2010) et Kaytranada (99.9%, 2016) figurent parmi les lauréats « majeurs », tandis que plusieurs s’attendaient à voir Drake triompher en 2012 pour Take Care (il a finalement perdu au profit de Metals de Feist). Le poids du prix a longtemps suffi à propulser un album au cœur du débat critique, du moins chez les auditeurs les plus passionnés.
Si cette influence semble moins marquée aujourd’hui, c’est peut-être davantage le reflet de l’évolution du paysage médiatique canadien que du prix lui-même. Le pays compte désormais moins de critiques musicaux à temps plein, moins de programmateurs, et les grands médias accordent de moins en moins d’espace aux artistes qui ne dominent pas déjà la conversation.
Malgré tout, Polaris continue d’exister sans jamais trahir ses principes. Vingt ans de palmarès montrent qu’il est impossible d’enfermer le prix dans un style ou un genre unique, mais il existe bel et bien une « esthétique Polaris ». Difficile à définir, mais immédiatement reconnaissable : singulière, indépendante, le reflet d’artistes qui mènent leur vision jusqu’au bout.
Le jury, lui, reste au cœur du processus. Plus de 200 personnes votent pour établir les listes longue et courte, avant que 11 grands jurés ne s’enferment dans une salle pour débattre et choisir le lauréat. Pas question de notoriété ni de couverture médiatique : seul compte cet insaisissable « mérite artistique ».
Depuis peu, le Polaris a aussi étendu son modèle de jury au-delà de l’album de l’année. Cette édition a marqué l’arrivée du tout premier Prix de la chanson SOCAN Polaris, décerné à Mustafa pour « Gaza Is Calling », une œuvre qui illustre parfaitement sa capacité à mêler des thèmes graves à une écriture intime et personnelle. Absent lors de la cérémonie, l’auteur-compositeur torontois a tout de même offert à cette nouvelle distinction un lauréat à la hauteur.
Le prix Polaris rend aussi hommage aux albums sortis avant 2006 grâce au Prix du patrimoine Polaris de la famille Slaight. Cette année, Jane Siberry est honorée pour The Speckless Sky (1985) et The Organ pour leur unique album Get That Gun (2004), désormais considéré comme un classique queer post-punk. Des choix qui s’inscrivent pleinement dans l’esprit Polaris : des disques qui n’ont peut-être pas atteint la notoriété grand public de leurs pairs, mais qui ont marqué la culture canadienne, influencé la scène et laissé une empreinte durable.
Rassurant, donc, de constater qu’il existe encore un espace pour ce type de reconnaissance.