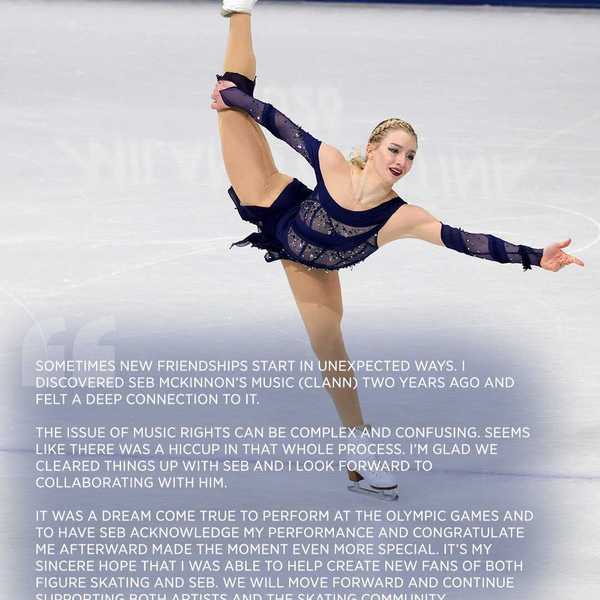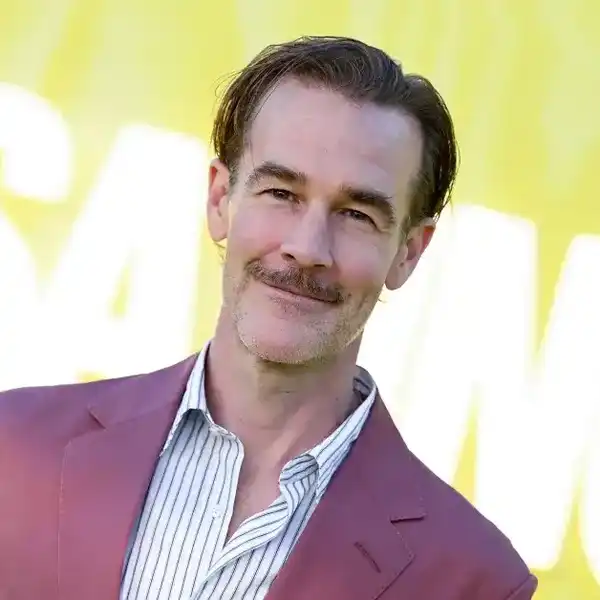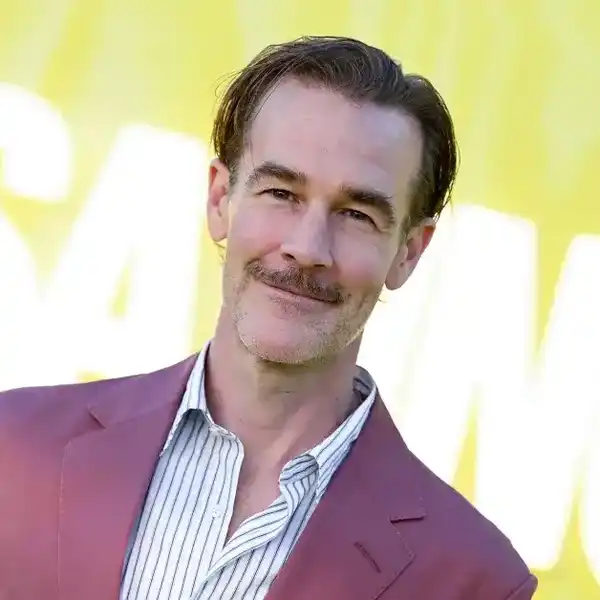Erin Benjamin, de l’Association canadienne de musique en direct, affirme que « la musique est la pierre angulaire de notre identité culturelle » dans une lettre ouverte percutante
À l’approche des élections fédérales du 28 avril, Erin Benjamin souligne le rôle essentiel de la musique canadienne dans un contexte marqué par l’incertitude et l’instabilité croissantes au pays. Elle invite également les citoyens à interpeller leurs candidats fédéraux sur l’avenir de la musique live.

La musique canadienne ne se résume pas à ses retombées économiques : elle est au cœur de notre identité nationale.
C’est le message central d’une lettre ouverte rédigée par Erin Benjamin, présidente-directrice générale de l’Association canadienne de musique en direct, en amont des élections fédérales du 28 avril. Elle y exhorte les responsables politiques à reconnaître l’importance culturelle de la musique pour le pays.
Sans jamais nommer le président américain, évoquer les tarifs douaniers ni qualifier le Canada de « 51e État », la lettre situe clairement le pays dans une période d’incertitude. Elle pose une question essentielle : que signifie vivre au Canada aujourd’hui, et à quoi ressemblera le pays demain ?
Dans ce climat, Benjamin insiste sur l’urgence pour les décideurs de prendre la pleine mesure des retombées économiques et culturelles du secteur de la musique live au Canada.
« Face aux défis générationnels d’aujourd’hui, à l’aube de l’avenir de notre nation, le temps est venu d’intégrer pleinement cette formidable industrie aux systèmes et aux politiques qui façonnent notre société, pour le bénéfice de tous les Canadiens », écrit-elle.
La lettre ouverte d’Erin Benjamin s’appuie sur la toute première évaluation de l’impact économique de la musique live au Canada : l’étude Hear and NowHear and Now, récemment publiée par l’Association canadienne de musique en direct (CLMA). Celle-ci révèle que la musique live a contribué pour 10,92 milliards de dollars au PIB canadien en 2023, soutenant plus de 100 000 emplois à travers le pays. Mais, comme le rappelle Benjamin, l’impact de la musique dépasse largement les considérations économiques.
« C’est un élément central de notre tissu culturel, qui façonne la façon dont nous nous connectons et nous définissons en tant que Canadiens. Face à une incertitude et une instabilité croissantes, nous risquons de perdre non seulement des opportunités économiques cruciales, mais aussi l’essence même de notre identité nationale », écrit-elle.
Benjamin poursuit en interpellant directement les décideurs politiques sur les conséquences d’un manque de soutien au secteur :
« Qui sommes-nous si nos artistes ne peuvent pas continuer à créer et à se produire en raison des pressions financières liées au coût des tournées, à l’accès aux concerts et à la diminution des ressources et des soutiens ? Qu’adviendra-t-il de notre sens de la communauté, de nos expériences communes, si nous perdons nos infrastructures culturelles… les salles, les festivals et les espaces qu’offre la musique live ? »
Cette prise de parole s’inscrit dans un dialogue plus large autour de la culture canadienne, dans un climat de fierté nationale croissante, souvent opposée à l’influence dominante des États-Unis. L’industrie musicale a su canaliser cette fierté, comme en témoignait la programmation des Junos 2025.
Au-delà des clichés publicitaires — slogans de hockey ou bières patriotiques — plusieurs figures du milieu culturel plaident pour une reconnaissance plus profonde du rôle des arts dans la souveraineté canadienne.
Ana Serrano, présidente de l’Université OCAD, le rappelait dans un éditorial récent du Toronto Star :
« Les arts, la culture et le patrimoine du Canada ont eu un impact direct sur le PIB de près de 61 milliards de dollars en 2023. Il y avait 645 900 emplois à temps plein et à temps partiel. »
« Ces industries sont à la fois des moteurs économiques et civiques. Elles contribuent à renforcer la résilience des communautés, à promouvoir la reconnaissance mondiale et à refléter la diversité du Canada. »
C’est dans cet esprit que la musicologue Rosheeka Parahoo insiste sur le rôle central que joue la musique dans la construction identitaire du pays. « Le besoin de définir, d’affiner et de réaffirmer ce que signifie être Canadien n’a jamais été aussi fort », écrit-elle dans The Conversation.
Elle rappelle les débats des années 1960 et 1970 sur la domination de la musique britannique et américaine dans les ondes canadiennes, qui avaient mené à la création du CRTC et à l’instauration des règles de contenu canadien. Ces mesures ont permis de faire émerger une génération d’artistes locaux. Aujourd’hui, cependant, le recul du financement dans les arts menace cette dynamique. La diffusion des récits locaux et régionaux devient plus difficile, prévient-elle.
« C’est le moment d’investir dans les arts et dans l’industrie musicale canadienne, non seulement pour préserver son passé, mais aussi pour garantir que nous continuons à raconter des histoires audacieuses, complexes et typiquement canadiennes », conclut Parahoo.
Mais cet élan de fierté culturelle n’est pas sans zones d’ombre. Le nationalisme, aussi culturel soit-il, comporte des risques lorsqu’il exclut certains groupes ou qu’il sert à légitimer des violences historiques. L’universitaire anishinaabe Riley Yesno, dans un texte percutant publié par le Toronto Star, témoigne du malaise que peuvent ressentir les communautés autochtones face à ce sursaut patriotique.
« Je ne pense pas que la plupart des Autochtones seraient pro-Trump, loin de là. C’est plutôt que, de ce point de vue, c’est difficile de vivre ce moment patriotique – d’être obligé d’adhérer à une puissance coloniale célèbre par peur d’une autre. »
Au-delà de toute logique nationaliste, investir dans la musique canadienne, c’est avant tout miser sur l’avenir des artistes, des salles de spectacles, des festivals, et des communautés qui s’y retrouvent. C’est donner une voix aux talents émergents et un espace aux histoires locales pour s’exprimer.
« L’histoire de la musique live est importante pour les Canadiens — nos artistes chéris et nos données en sont la preuve », écrit Erin Benjamin.
Sa lettre se conclut sur un appel clair à l’action : elle encourage les citoyens à écrire à leurs candidats fédéraux pour leur demander de s’engager en faveur de la musique en direct. Parmi les mesures proposées : investir dans le Fonds de la musique du Canada, créer un nouveau programme pour soutenir la croissance des festivals, et allouer 1 % des dépenses globales aux arts et à la culture.
Lire la lettre complète ici.